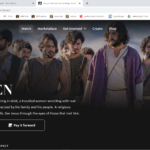Petit film américain fidèle à la tradition de Provence, réalisé par EWTN (date un peu)
LA TRADITION PROVENÇALE
La tradition provençale (du latin tradere: transmettre) est immémoriale et remonte aux premiers siècles de notre ère; elle rapporte qu’après la résurrection du Seigneur, Marie-Madeleine, Marthe, Lazare et leurs compagnons, chassés par les persécutions des juifs et contraints à l’exil, arrivèrent par bateau jusqu’en Gaule, à Marseille puis aux Sainte-Marie-de-la-mer.
Marthe ira en Avignon et à Tarascon, Lazare à Marseille, et Marie-Madeleine, après être restée un moment avec Lazare pour annoncer l’évangile, trouvera refuge dans la grotte de la Sainte-Baume, pour y finir ses jours dans la prière et la pénitence (30 ans selon la tradition). Sept fois par jour, dit-on, des anges la transportaient plus haut, là où a été construite la petite chapelle du Saint-Pilon restaurée en 2015.
La grotte est sur le versant Nord d’une longue barre rocheuse de 12 km; d’une altitude de 1000 mètres en moyenne. La forêt datant de l’époque primaire s’arrête au pied de la falaise. C’est aussi le paradis des botanistes.
En résumé:
EVENEMENTS LIES A LA DÉCOUVERTE DES RELIQUES DE STE MARIE MADELEINE
A partir de l’œuvre encyclopédique de l’Abbé Faillon et d’autres documents historiques, Marie-Christine Trouillet, archiviste et paléographe, présente les évènements liés à la découverte des reliques de sainte Marie-Madeleine à Saint-Maximin et à leur approbation pontificale par Boniface VIII. Voici les sujets historiques développés ci-après :
- L’événement de 1279-1280 : la découverte des reliques par Charles II d’Anjou
- l’invention « découverte »,
- l’élévation,
- la translation.
- La valeur des critiques dirigées contre la tradition provençale :
- Launoy, Mgr Duchesne, Mgr Saxer ;
- les « traditions orientales »,
- Vézelay ?
- Quelques preuves des traditions provençales par les événements de 1279-1280 :
- Bernard Gui, Philippe de Cabassole, les prélats, Rome, Charles II, les dominicains, les bénédictins.
- les textes découverts – le comput ; la formule « anno Navitatis » ; l’inscription « Hic requiescit corpus Mariae Magdalenae » ; La crypte et les sarcophages.
Ces nombreux faits qui parlent en la faveur de l’authenticité des reliques et de leur découverte en Provence par Charles de Salerne, font le lien entre l’histoire et la tradition. Le texte ci-après a été préparé par Marie-Christine Trouillet pour l’association qui soutient la tradition des saints de Provence. Vous pouvez télécharger ce fichier en format pdf.
Découverte des reliques de Marie-Madeleine à la Ste Baume par Marie-Christine Trouillet (fichier pdf : 315 Ko)
Pourquoi vénérer les reliques des saints: cliquez ici.
PAR MARIE-CHRISTINE TROUILLET
Archiviste – paléographe, 1980
Sainte Marie-Madeleine
Il lui a été beaucoup pardonné parce qu’elle a beaucoup aimé.
Ce sont toutes les traditions apostoliques provençales qui font l’objet de l’étude de l’association « Sainte-Marie-Madeleine en Provence », puisqu’elles sont liées entre elles. Mais il n’est pas possible, en une fois, de parler de toutes.
Nous avons donc choisi de commencer par sainte Marie-Madeleine. Pourquoi ? Pour diverses raisons. D’abord, c’est la patronne de notre association ; ensuite, parmi tous les saints de Provence, elle brille d’un éclat particulier cette illustre pécheresse repentie, à qui Notre Seigneur a pardonné parce qu’elle avait beaucoup aimé, qui est nommée l’Apôtre des Apôtres dans l’Ordre de Saint Dominique, et que l’on a qualifiée d’héroïne de l’Évangile. D’autre part, nous éprouvons pour elle un intérêt tout particulier. Enfin et surtout, c’est que nous nous trouvons dans le 7e centenaire de l’invention de ses reliques à Saint-Maximin : 1279-1280 ; invention qui a été et qui est encore accusée d’imposture.
C’est pourquoi il nous a paru nécessaire de rouvrir un dossier que d’aucuns considèrent comme clos, estimant la question désormais réglée, et aussi parce qu’actuellement seuls les adversaires de nos traditions se font entendre.
Or, il ne doit pas nous être indifférent de savoir si oui ou non cette « perle étincelante », ce « flambeau du monde », ainsi que la nomment les litanies composées en son honneur, a fait pénitence, est morte et a été ensevelie à quelques dizaines de kilomètres de chez nous et si ce sont effectivement ses reliques qui sont présentées à notre vénération.
La question faisant l’objet d’une vaste polémique, il n’est pas possible d’aborder et de discuter ici tous les problèmes, ni de dresser un catalogue des preuves de cette authenticité ; nous donnerons seulement les plus remarquables et les plus parlantes à titre d’exemple afin que ce que l’on pourrait appeler une « ténébreuse affaire » devienne claire pour vous et qu’instruits sur ces faits, vous puissiez à votre tour en instruire d’autres, reprenant à votre compte la Parole de Notre Seigneur à Marie-Madeleine au matin de Pâques : « Va, dis à mes frères »…
L’événement de 1279-1280 : la découverte des reliques.
L’événement s’est déroulé en trois temps que l’on appelle l’invention, l’élévation, la translation.
L’invention des reliques
Quel est le contexte ? De tout temps, les Provençaux sont persuadés que Marie, Marthe, Lazare, leur frère (la famille de Béthanie), avec Maximin, Sidoine, Marie Jacobé et Salomé, chassés de Judée par les Juifs, ont échoué, à bord d’un navire sans voiles ni gouvernail, sur les côtes de Provence. Ils ont évangélisé la région ; Marie-Madeleine a fait pénitence trente ans à la Sainte-Baume, puis a été ensevelie par Maximin, premier évêque d’Aix, à l’endroit où en 1279 s’élève l’église du prieuré bénédictin dédiée à ce saint évêque, au village du même nom. Mais on ignore alors à quel endroit se trouvent ses reliques dans cette église, on est incapable de les montrer.
Au même moment, en 1267, à Vézelay, les moines bénédictins viennent d’obtenir du légat en France une reconnaissance indirecte des reliques dont ils ont fait la translation et qu’ils disent être de sainte Marie-Madeleine.
Deux corps de sainte Marie-Madeleine, cela faisait un de trop. Il fallait éclaircir cette question, faire cesser l’incertitude résultant de ces contradictions. C’est ce qui détermina l’intervention de Charles de Salerne.
Qui est ce personnage ? Charles, prince de Salerne, alors lieutenant en Provence pour son père, est le fils de Charles d’Anjou, comte de Provence, et par conséquent le neveu du roi saint Louis. Il est lui-même père d’un saint, Louis de Brignoles, évêque de Toulouse.
Les annales et les chroniques nous apprennent que pour s’instruire il se rendit à Aix, fit compulser les livres d’histoire et les annales, interrogea les vieillards sur les traditions locales et ordonna toutes les recherches qui pouvaient l’éclairer.
Il acquit ainsi la certitude que saint Maximin avait inhumé le corps de l’illustre pénitente à l’endroit où était construite l’église de la petite ville qui porte son nom. Il s’y rendit donc avec sa suite, l’an de grâce 1279, au mois de décembre. Par son ordre des fouilles furent entreprises, les tombeaux visités, les murs et le sol de l’église sondés… On finit par atteindre la crypte qui avait été murée et remplie de terre.
Enfin, le 9 décembre, « le prince, nous dit le chroniqueur, avait dépouillé sa chlamyde, et, armé d’une houe, il creusait la terre avec une telle ardeur qu’il était inondé de sueur, lorsqu’un ouvrier rencontra un tombeau de marbre ». On essaya de l’ouvrir ; aussitôt il s’en échappa une odeur merveilleuse, qui donna à penser aux assistants que le corps qu’ils apercevaient était le trésor cherché.
Écoutons encore les chroniqueurs qui ont raconté la scène. Ils sont proches des faits dont ils parlent et nous reviendrons sur la valeur de leur témoignage dans la deuxième partie, lorsque nous discuterons de l’authenticité des faits.
Le signe du parfum
Bernard Gui écrit : « Il se répandit une odeur de parfum comme si on eut ouvert un magasin d’essences les plus aromatiques ».
Philippe de Cabassole, chancelier de la reine Jeanne, apprit de la bouche même de Robert, fils de Charles, ce qu’il raconte : « avant qu’on eût pu voir ce que renfermait le tombeau, un parfum d’odeur merveilleuse qui en sortit embauma tous les assistants et les invita às’approcher pour voir ce qui pouvait produire une senteur si extraordinaire ».
Ce parfum est le premier signe caractéristique de la découverte d’un corps saint, les exemples ne manquent pas, et telle fut la pensée des assistants. On ne peut s’empêcher, puisqu’il s’agit de Marie-Madeleine, de penser au parfum qu’elle versa à deux reprises, sur les pieds et la tête de Notre Seigneur, et qui embauma toute la maison.
Tels sont les faits qui constituent ce que l’on appelle l’« invention » des reliques, au sens du mot latin « invenire », c’est-à-dire découvrir, trouver, et non imaginer.
L’élévation
Quelles grandes qu’aient été la joie et l’impatience de Charles de Salerne, il remit à plus tard l’examen de l’intérieur du tombeau, afin que cet examen pût être fait avec toutes les formalités nécessaires pour garantir l’authenticité des reliques.
Il scella donc la table de marbre qui recouvrait les reliques et convoqua pour le 18 du même mois les évêques du comté de Provence, parmi lesquels l’archevêque d’Aix, Grimier de Vicedominis, et celui d’Arles, Bernard de Languisel.
Après avoir reconnu les sceaux, on ouvrit le tombeau. On trouva le corps entier, moins la mâchoire inférieure et une jambe. Des cheveux entouraient le crâne.
Reprenons Bernard Gui :
« On trouva que la langue de sainte Madeleine était inhérente à la tête et au gosier… Il en sortit une certaine racine avec un rameau de fenouil assez long, qui s’étendait au-dessous. Ce que, ceux qui étaient présents admirèrent et considérèrent clairement de leurs propres yeux. Et moi, qui écris ces choses, j’en ai entendu souvent faire le récit, avec fidélité et dévotion, par plusieurs de ceux qui en furent témoins. Cette racine fut ensuite divisée en plusieurs particules, que l’on honore en divers lieux comme des reliques. »
Et Philippe de Cabassole :
« On trouva dans ce saint corps un signe très assuré de sa vérité, c’est-à-dire un rameau verdoyant qui sortait de sa langue sacrée, de cette langue avec laquelle l’apôtre des apôtres annonça aux apôtres mêmes que Jésus-Christ était ressuscité des morts et prêche ce mystère aux nations. »
C’est là un deuxième signe, mais le troisième, plus remarquable et plus éclatant, et qui caractérise réellement Marie-Madeleine est ce qu’on a appelé le « noli me tangere ». C’est ainsi que l’on a nommé la particule de chair, recouverte de peau, restée adhérente au-dessus de l’arcade sourcilière gauche, à l’endroit du front qu’ont touché les doigts de Notre Seigneur ressuscité lorsqu’ apparaissant à Marie-Madeleine, près du tombeau vide, au matin de Pâques, après qu’il l’eut appelée par son nom, « Marie ! », elle se précipite à ses pieds et qu’il lui dit : « Noli me tangere ! » (« Ne me touche pas ! »).
Voici ce qu’en dit le Cardinal de Cabassole :
« Le front indique la vérité du corps par une marque toujours existante au côté droit [du spectateur] au-dessus de la tempe ; celui qui peut détruire toutes choses et conserver ce qui est corruptible, a préservé contre les lois de la nature de toute dissolution la place où s’est par le contact imprimée l’empreinte de se main sacrée, cela est évident pour tous ceux qui la considèrent ».
Ce morceau de chair s’est conservé en place jusqu’au milieu du XVIIIe siècle. Cela fut constaté à plusieurs reprises par des médecins lors des différentes vérifications des reliques, au cours desquelles des inventaires ont été dressés. Une enquête juridico-médicale fut ordonnée le 3 avril 1640 et présidée par Louis de Valois, comte d’Artois et lieutenant général de Provence. Elle fut conduite par plusieurs savants dont le célèbre Gassendi de Digne et trois médecins. Un acte notarié en fut dressé. On conclut à un phénomène extra-naturel. Cette particule se détacha avant 1780, date où cela est rapporté par un inventaire écrit au cours d’une nouvelle vérification des reliques.
A côté du corps on trouva une amphore contenant de la terre. Appelée par la suite sainte ampoule, elle contenait de la terre du Calvaire teinte du sang de Notre-Seigneur. Cette ampoule était exposée à la vénération des fidèles le Vendredi Saint, jour où le sang se liquéfiait. Elle a été volée en 1904.
Dans la poussière du tombeau on remua à diverses reprises un morceau de vieux liège, auquel on ne fit d’abord aucune attention. Enfin, cet objet étant revenu sous la main du prince, et celui-ci l’ayant pris pour le considérer de plus près, le liège se rompit en plusieurs morceaux et on trouva qu’il renfermait un petit parchemin avec une inscription latine. Cette inscription fut lue avec beaucoup de difficultés. Bernard Gui nous dit :
« Le parchemin très ancien je l’ai lu moi-même qui écris ce récit et je l’ai vu dans la sacristie oùon le conserve comme un témoignage de vérité ».
Et voici le texte (en traduction) :
« L’an de la Nativité du Seigneur 710, 6e jour de décembre [ou 715, 111, jour de décembre, selon que l’on établit la ponctuation], dans la nuit et très secrètement, sous le règne du très pieux Eudes, roi des Français, au temps des ravages de la perfide nation des Sarrasins, ce corps de la très chère et vénérable sainte Marie-Madeleine a été, par crainte de ladite perfide nation, transféré de son tombeau d’albâtre dans ce tombeau de marbre, après en avoir enlevé le corps de Sidoine, parce qu’il y était mieux caché».
Un acte de relation de ces faits fut dressé et le tombeau de nouveau scellé.
La translation
Le Prince Charles convoqua pour le 5 mai suivant les prélats du comté de Provence, les archevêques de Narbonne, d’Arles et d’Aix, des abbés, des religieux, des prélats, ses barons, le clergé et le peuple. En leur présence il fit rompre les sceaux et ouvrir le tombeau.
Au milieu des reliques on trouva un globe enrobé de cire et à l’intérieur cette courte inscription que l’on eut encore du mal à déchiffrer :
« Hic requiescit corpus Mariae Magdalenae ». (Ici repose le corps de Marie-Madeleine).
Reprenons le cardinal de Cabassole :
« Sur l’ordre du prince, les prélats retirèrent les ossements, les enveloppèrent dans une étoffe précieuse et les portèrent en procession aidés par 200 religieux ».
Le 25 mai 1281 le corps fut placé dans un reliquaire d’argent exécuté à cette intention ; le 10 décembre 1283 le chef fut mis dans un reliquaire en forme de buste en présence d’officiers laïques et de prêtres, religieux et séculiers. Sur le chef fut placée la couronne de Charles 1er, qu’il avait envoyée après l’élévation, en don et hommage à sainte Marie-Madeleine.
Après la reconnaissance des évêques et des prélats, Charles de Salerne souhaitait la confirmation de l’Église en la personne de celle du Pape.
Mais les événements retardèrent son projet. Les Vêpres Siciliennes du 30 mars 1282 chassèrent les Angevins de Sicile, remplacés par les Aragonais, et Charles de Salerne, fait prisonnier devant Messine le 5 juin 1284, fut retenu captif à Barcelone jusqu’en 1288.
Devenu roi en 1285, après la mort de son père, et libéré trois ans après, son projet fut alors retardé par la papauté. Après Nicolas IV préoccupé par la croisade et Célestin V par son ermitage, c’est seulement à Boniface VIII que Charles II put s’adresser en 1294.
Le fait est rapporté par Philippe de Cabassole :
« Cependant Charles de Salerne, désirant informer le pape de cette découverte, porta lui-même à Rome les deux inscriptions et la tête de sainte Marie-Madeleine. Le pape, sachant qu’on possédait dans les reliquaires du Latran une relique de la même sainte la fit apporter; et on put constater qu’elle s’adaptait parfaitement au bas de la mâchoire; il la remit au roi, qui s’en montra tout heureux et reconnaissant ».
Boniface VIII accorda six bulles en une seule année, 1295. Les quatre premières, des 6, 7 et 8 avril donnèrent à Charles II le pouvoir d’établir des frères Prêcheurs à la place des bénédictins comme gardiens des reliques de sainte Marie-Madeleine à Saint-Maximin et à la Sainte-Baume.
Par les 5ème et 6ème bulles, datées du 14 juillet 1295, il reconnaît la fête, avec octave, de la translation des reliques de sainte Marie-Madeleine. Il octroie, en outre, des indulgences à tous ceux qui viendront en ces jours et en la fête du 22 juillet « visiter l’église de Saint-Maximin, dit-il, où repose le corps de sainte Marie-Madeleine ».
Depuis lors, les papes qui se sont succédé n’ont cessé de marcher sur les traces de Boniface VIII dans la reconnaissance des reliques de sainte Marie-Madeleine et des sanctuaires de Saint-Maximin et de la Sainte-Baume.
(C’est après 1295 qu’a été commencée, en l’honneur des saintes reliques, l’actuelle basilique de Saint-Maximin, la « fenestrado basilico », ainsi que l’a chantée Mistral. Elle a été élevée par les dominicains, fidèles gardiens, jusqu’à une époque récente, des reliques qui leur avaient été confiées, et monte d’un trait vers le ciel pour nous conduire à la contemplation même de Marie-Madeleine).
Comme nous venons de le dire trop rapidement, cette tradition n’est pas seulement celle de la Provence; elle a été reconnue, approuvée et propagée par l’Église.
Voyons maintenant en opposition la valeur des critiques.
Valeur des critiques dirigées contre la tradition provençale.
Les premières attaques contestant l’authenticité des reliques de Saint-Maximin ne remontent qu’au XVIe siècle, les prétentions de Vézelay constituant au contraire, comme nous le verrons plus loin, une reconnaissance de la tradition provençale.
Les trois principaux adversaires des traditions, dans l’ordre chronologique, sont : Launoy, Monseigneur Louis Duchesne, Monseigneur Victor Saxer. Le premier, janséniste et condamné comme tel par la Sorbonne au XVIIe siècle, était de ce fait hostile aux reliques et à tout culte des reliques ; le deuxième, que l’on a surnommé « le dénicheur de saints », a sévi à la fin du siècle dernier et au début de celui-ci ; le troisième est notre contemporain. Ce dernier, auteur d’une thèse de « théologie » sur « Le culte de Marie-Madeleine en Occident des origines à la fin du Moyen Age » et de divers articles sur la question, est actuellement la référence pour ceux qui rejettent les traditions provençales. Il convient de préciser que la plupart de ceux qui se rangent derrière lui ne connaissent que ses conclusions.
Voyons quelles thèses ces auteurs ont opposées aux traditions, quelles sont leurs méthodes de travail et quel crédit on peut accorder à leurs affirmations.
Ont été essentiellement opposées aux traditions provençales ce qu’on appelle les traditions orientales, les légendes bourguignonnes (de Vézelay) et la critique même des événements de 1279-1280 que nous avons décrits dans la première partie. Nous examinerons successivement ces trois points, nous attardant plus longuement sur le dernier puisque sa date le met à l’ordre du jour.
Les « traditions orientales ». (cf onglet « LA TRADITION ORIENTALE »)
EPHESE: Nous retiendrons deux textes qui, d’après Launoy et Mgr Duchesne, situent la tombe de sainte Marie-Madeleine à Ephèse.
Le premier est attribué à Grégoire de Tours dans le « De gloria martyrum » (« De la gloire des martyrs »). Mgr Duchesne écrit : « … La Madeleine, dont le tombeau était, dès le VIe siècle, un des lieux saints d’Ephèse »… « Grégoire de Tours, l’homme le plus renseigné de son temps en matière de pèlerinage, connaît ce sanctuaire : « In ea urbe [Ephèse], ut dicitur, Maria Magdalena quiescit, nullum super se tegumen habens ». (Dans cette ville, dit-on, repose Marie-Madeleine, dans un tombeau sans toiture).
Mais Grégoire de Tours n’est jamais allé à Ephèse ; il ne connaît ce tombeau que par « le voyageur syrien qui l’a aidé à transcrire les Actes des Sept Frères Dormants ».
Mgr Duchesne lui-même, pour d’autres questions, juge que les récits de Grégoire de Tours sont faits avec une « candeur admirable ». Il jette par ailleurs le discrédit sur l’autorité d’un historien qu’il ne déclare qu’ici infaillible, pour les besoins de sa cause.
En outre, on peut se demander si ce texte est authentique. Il manque en effet dans les manuscrits de Clermont, auxquels on accorde une grande valeur.
Le texte lui-même fait douter – que le corps repose dans un tombeau à découvert, est-ce cela un lieu saint ? En Asie, les lieux saints et les sanctuaires sont-ils d’autant plus illustres qu’ils sont plus abandonnés ? Aucun voyageur de cette époque ne nous révèle d’aussi étranges coutumes et assurément Grégoire de Tours ou celui qui a ajouté ce passage écrit : « ut dicitur », « à ce qu’on dit ». Il ne dit pas depuis quand la sainte y serait ensevelie ni par quel miracle perpétuel elle est protégée contre les intempéries et les profanations.
Un autre texte vient remarquablement infirmer la déclaration péremptoire de Mgr Duchesne. Il s’agit de la lettre collective adressée à la fin du Ile siècle par les évêques d’Orient au pape saint Victor, pour lui demander de les laisser continuer de célébrer la fête de Pâques selon l’usage qu’ils tenaient de saint Jean. Afin de mieux relever la dignité de leurs églises et leurs titres à la bienveillance du Souverain Pontife, ils ne manquent pas d’énumérer tout d’abord les Apôtres et les personnages contemporains morts en Asie, surtout à Ephèse. Il n’y est pas question de Marie-Madeleine. Or l’évêque d’Ephèse était alors Polycrate, né dans cette ville 25 ans après la mort de saint Jean. Les évêques qui l’avaient précédé sur ce siège étaient tous de sa famille : son propre aïeul aurait pu voir Marie-Madeleine à Ephèse si réellement elle y fut morte, et lui-même n’aurait pas manqué de le mentionner dans cette lettre : cela aurait été le plus beau titre de recommandation de son Église.
Quant à Launoy, il invoque une homélie de saint Modeste, évêque de Jérusalem au VIIIe siècle, citée par Photius, deux siècles plus tard. Or ce Photius est l’auteur du grand schisme de l’Église grecque. C’est peut-être pourquoi Mgr Duchesne, citant à son tour ce texte, le présente comme trouvé directement dans saint Modeste : « Modeste, évêque de Jérusalem, dans la première moitié du VIIIe siècle, mentionnait le lieu saint d’Ephèse dans une de ses homélies »…
Quant à ce passage, il subit également des raccourcis dans la citation donnée par Launoy. Enfin, ce texte se réfute par lui-même : cette « Madeleine de laquelle le Sauveur chassa sept démons fut toute sa vie vierge et dans le récit de son martyre il est dit qu’à cause de sa parfaite virginité et son excellente pureté, elle parut à ses bourreaux comme un limpide cristal… Madeleine, devenue chef des disciples, à cause de sa pureté et de l’amour qu’elle eut pour le Sauveur, fut surnommée Marie, comme sa divine Mère ».
Il est clair que ce passage ne peut être retenu : il n’est pas nécessaire d’être docteur en théologie pour en voir la contradiction interne et pour savoir qu’il est en opposition avec l’Évangile sur le nom même du personnage : « Maria quae vocatur Magdalena » (Luc VII 2).
Il y a d’autres preuves de citations personnelles de textes dans Launoy et Mgr Duchesne. Rappelons simplement que le pape Benoît XIV décora Launoy des deux titres flatteurs de « menteur impudent et écrivain méprisable ».
VEZELAY
Monseigneur Duchesne écrit : « C’est sous le gouvernement de l’abbé Geoffroy, installé en 1037, que l’on vit pour la première fois apparaître à Vézelay le culte et le pèlerinage de sainte Marie-Madeleine. Vézelay devint alors le sanctuaire de sainte Marie-Madeleine, tout comme Fleury était celui de saint Benoît. Le nom de sainte Madeleine entra dans la titulature officielle de l’abbaye dès l’année 1050. Ces hommages s’adressaient à un tombeau. Le corps de la sainte était censé reposer dans l’église du monastère ».
D’où provenaient ces reliques ? A cette question importune posée par les pèlerins (les chrétiens du XIe siècle n’étaient donc pas aussi naïfs et « innocents » qu’on voudrait nous le faire croire !), on donna cette réponse qui nous est connue par une relation du XIe siècle
« Beaucoup demandent comment le corps de Marie-Madeleine, morte en Judée, a pu être apporté d’aussi loin dans les Gaules. Mais il n’y a qu’un mot à leur dire : c’est que rien n’est impossible à Dieu qui fait tout ce qu’il veut et pour qui rien n’est difficile de ce qui est utile au salut des hommes. »
Cela apparaît dans les nouveaux récits que publièrent ensuite les moines de Vézelay :
« Au temps de Carioman, roi des Francs, l’évêque Adalgar vint providentiellement à Vézelay avec l’illustre chevalier Adelelme, frère d’Eudes, abbé du monastère ». Le Pontife, ayant parlé du grand amour que Jésus avait pour Marie-Madeleine, touché jusqu’aux larmes, Adelelme s’écria : « De cette sainte, dont vous célébrez les vertus, j’ai vu, dans mon enfance, le glorieux tombeau ; et je sais où il se trouve ». Il décide alors, à la demande de son frère, d’aller à la recherche du tombeau.
« Arrivés dans la ville d’Arles, ils voient toute la région dévastée par les Sarrasins, mais ils continuent leur route et arrivent à l’endroit où est caché le trésor ».
Ils échappent miraculeusement aux Sarrasins et emportent les corps de sainte Marie-Madeleine et de saint Maximin.
Cette version des faits ne dut pas encore satisfaire les curiosités, car une troisième explication fut donnée :
« L’an 749, sous le règne de Louis le pieux et de son fils Charles, le comte Gérard de Bourgogne et Berthe son épouse, consacrèrent leur fortune à la construction d’églises et monastères… Mais les perfides Sarrasins, envahissant la Provence, détruisent Aix la capitale… Or l’on savait, au loin et depuis longtemps, que le corps de la bienheureuse Marie-Madeleine avait étéenseveli dans le territoire d’Aix par le saint pontife Maximin, dont les restes y furent aussi déposés. Apprenant cela, Gérard et Eudes, abbé du monastère de Vézelay, envoyèrent le frère Badilon pour s’enquérir de l’endroit précis où se trouvaient ces corps précieux. »
Après bien des recherches il le trouva :
« Le tombeau indiquait bien quel corps y était renfermé, car, sur toute la surface il y avait, en sculpture, les scènes évangéliques où Marie-Madeleine fait l’onction dans la maison de Simon, où elle s’adresse à Jésus qu’elle a pris pour un jardinier, où elle interroge l’ange, et où elle annonce aux apôtres la résurrection du Sauveur »…
Badilon, après une apparition de la sainte, revient de nuit au sépulcre, prend le corps sacré, le dépose sur un chariot et, par la route de Salon, arrive jusqu’à Vézelay.
D’où Mgr Duchesne déduit triomphalement que la tradition provençale est née en Bourgogne dans là seconde moitié du XIe siècle. Avant même d’invoquer le témoignage des textes, faisons appel au bon sens, qui ne semble pas être la chose du monde la mieux partagée. A qui profite le « pieux larcin » ? Aux Bourguignons, bien sûr. Mais quel est leur intérêt d’aller imaginer la venue et l’ensevelissement en Provence de Marie-Madeleine, Maximin, Marthe et Lazare ? Aucun… La seule explication alors possible est qu’ils n’ont rien imaginé : avant les relations de Vézelay existait la tradition provençale. Si, pour faire admettre l’authenticité des reliques qu’ils disaient être de Marie-Madeleine, les Bourguignons affirment qu’elles viennent de Provence et s’en tiennent à cette dernière version des faits, c’est qu’il était de « notoriété publique » qu’elles ne pouvaient venir que de là.
Et les textes ? Les trois versions différentes prouvent l’embarras des moines de Vézelay; nous ne connaissons rien de semblable dans la tradition provençale.
Première explication : le corps vient de Judée, mais on ne dit pas comment : tout est possible à Dieu.
Vient alors une deuxième explication. Narrée par deux récits comportant d’importantes variantes, elle décrit l’expédition de chevaliers chrétiens en Provence occupée par les Sarrasins, afin de soustraire les reliques à ces profanateurs.
Avant de donner le lieu de provenance des reliques, Vézelay en affirme l’identité. Ce n’est qu’après la bulle de Léon IX de 1050 qui ajoute sainte Marie-Madeleine comme patronne de Vézelay à la Mère de Dieu et aux saints apôtres, et consacre ainsi directement le culte de Vézelay et indirectement la garde des reliques que, se sentant plus forts, les moines de Vézelay racontent les circonstances du « pieux larcin ».
Même sans entrer dans le détail de ces deux narrations et sans en faire une étude exhaustive, il est clair qu’elles soulèvent plusieurs questions ; de l’une à l’autre, les chevaliers diffèrent : c’est d’abord Adelelme, frère d’Eudes, puis le frère Badilon, envoyé par le comte Gérard, dit comte de Bourgogne, alors qu’il n’a jamais porté ce titre. La chronologie, quant à elle, est des plus fantaisistes : la première est dite se passer au temps de Carloman, la seconde est placée en 749, « sous le règne de Louis le pieux et de son fils Charles », qui étaient loin d’être nés à ce moment-là ; quant à Gérard de Vienne, c’est vers 860 qu’il fonda l’abbaye de Vézelay.
Une autre variante entre les deux textes est à retenir : lors de la première expédition, ce sont les deux corps de saint Maximin et de sainte Marie-Madeleine qui sont enlevés, tandis que dans la seconde il n’est plus question que de celui de Marie-Madeleine. Ce point pose un autre problème : Mgr Duchesne a écrit qu’« il ne vint de Provence aucune réclamation et l’opinion donna pleine créance aux explications des religieux bourguignons ».
Mais si nous n’avons pas de trace de cette controverse, nous pouvons cependant penser que ce retranchement d’un corps d’un texte à l’autre est une concession bourguignonne aux réclamations provençales. D’ailleurs à ce moment-là les Provençaux étaient, comme nous l’avons dit en commençant, incapables de montrer les reliques dans l’église de Saint-Maximin ; la Provence n’était pas en période de force, elle n’était pas remise des invasions sarrasines ; le temporel de l’abbaye Saint-Victor, dont dépendait le prieuré de Saint-Maximin, était en train de se reconstituer ; cependant « l’église d’une admirable grandeur, élevée en l’honneur du bienheureux Maximin… au milieu d’un royaume désert par l’effet de la violence des Sarrasins, reste encore debout dans la splendeur de ses murs ». Sans les reliques de Marie-Madeleine, comment expliquer cette insigne église en ce lieu ? Et pourquoi cette dédicace à saint Maximin ?
De plus, il est remarquable que le pèlerinage de Vézelay faisait question : au début du XIIe siècle il est interdit par l’évêque d’Autun, Norgaud, pour preuves insuffisantes. Rien de tel ne s’est jamais passé en Provence. Cet interdit fut cassé à la demande des religieux, mais sans enquête, par une bulle de Pascal II.
C’est à partir de cette période que le pèlerinage de Vézelay connut son plus grand succès. Mais cela, au lieu d’être une preuve contre la tradition provençale, lui est au contraire favorable, puisque cette faveur reposait sur les récits des moines touchant la translation du corps de Marie-Madeleine depuis la Provence à l’époque des Sarrasins. C’est ce récit qui est repris par les chroniques du XIIe siècle.
Cependant, le doute subsistait précisément sur le fait de cette translation : les pèlerins continuaient d’aller à la Sainte-Baume et à Saint-Maximin « où gisait le corps de sainte Marie-Madeleine », et le plus illustre d’entre eux est saint Louis.
Pour mettre fin à ce doute les religieux de Vézelay firent exhumer les reliques en 1265 en présence de l’évêque d’Auxerre et de Pierre, qualifié évêque de Panéade ; on trouva des ossements, des cheveux de femme et des lettres d’un « très glorieux roi Charles », sans plus de précision de date ni d’autre chose.
Néanmoins, les religieux firent l’élévation solennelle de ces reliques en avril 1265, en présence notamment de saint Louis et du légat. A cette occasion le légat accorda une indulgence à ceux qui visiteraient l’église à une des quatre fêtes de sainte Marie-Madeleine et reçut une côte qu’il légua en 1281 à l’église métropolitaine de Sens. Dans les lettres qu’il rédigea pour ces deux événements, le légat, devenu pape sous le nom de Martin IV à l’époque du second, reconnaît, mais indirectement, que le corps de sainte Marie-Madeleine est à Vézelay : il n’y a pas là de reconnaissance officielle et solennelle semblable à celle qui suivit la découverte faite à Saint-Maximin en 1279-1280. Il est temps de revenir à cette découverte.
Preuve des traditions provençales par les événements de 1279-1280.
Les originaux des chartes de Charles de Salerne et des évêques sont perdus, comme nous l’avons dit; le récit ne nous en est donné que par des copies tardives et par des annalistes et des chroniqueurs, proches dans le temps des événements. Voyons d’abord ce que vaut le témoignage de ces derniers.
Bernard Gui
Est-il connu ou non ? Pouvons-nous lui faire confiance ?
Léopold Delisle, qui a rédigé un catalogue des manuscrits de la Bibliothèque nationale, a écrit dans sa notice sur les manuscrits de Bernard Gui : « Né dans le Limousin en 1261 ou 1262, Bernard entra, tout jeune encore, dans l’Ordre des Frères Prêcheurs au couvent de Limoges. Il ne tarda pas à être distingué comme un religieux sur lequel on pouvait fonder de hautes espérances. Il fut prieur d’Albi, de Carcassonne, de Castres et de Limoges où il reçut le pape Clément V, il fut inquisiteur de France, procureur général de son Ordre.
Au milieu d’occupations si multiples et si absorbantes, Bernard Gui sut trouver le temps nécessaire pour composer des ouvrages historiques d’une étendue et d’une valeur considérables. Depuis sa jeunesse jusqu’à la veille de sa mort, il a tenu la plume pour préparer, rédiger et compléter d’immenses compilations qui embrassent l’histoire générale, l’hagiographie, les annales des Dominicains et différents détails de l’histoire civile et religieuse.
Il nous a conservé sur l’histoire du Midi de la France au XIIIe siècle et au commencement du XIVe une multitude de renseignements précieux, dont l’équivalent n’existe nulle part ailleurs.
Un autre genre de mérite ne saurait lui être contesté : il a puisé tous les moyens qu’on avait de son temps pour arrivera la connaissance de la vérité »… « il ne confond pas ce qui est simplement probable avec ce qui lui parait démontré »… Nous pourrions ajouter : à la différence de Mgr Duchesne. Bernard Gui affirme avoir vu lui-même les textes trouvés dans le sarcophage et avoir eu du mal à les lire.
Philippe de Cabassole
Comme nous l’avons dit, ce cardinal, chancelier de la reine Jeanne, apprit de Robert même, fils de Charles de Salerne, les faits qu’il nous a rapportés. Mgr Duchesne n’a fait aucune allusion à son récit.
Les prélats
Les archevêques de Narbonne, d’Aix et d’Arles ont vu l’inscription, le liège, le globe enrobé de cire, le parchemin, les textes difficiles à lire. Mais Mgr Saxer écrit : « ou bien c’est un des prélats présents le 18 décembre qui l’y aura laissé tomber [le texte] de sa manche au cours de la vérification ». Cette affirmation toute gratuite de cet hypercritique nous en dit long sur ses méthodes d’investigation et à notre tour nous lui demandons ses preuves.
Rome
Le pape et ceux qui ont participé à l’enquête avant de conclure officiellement ont étudié les preuves apportées par Charles d’Anjou les textes et le crâne de sainte Marie-Madeleine, qui a même été complété par la mâchoire inférieure conservée au Latran. Cela n’empêche pas Mgr Saxer d’écrire, toujours sans preuve, que Boniface VIII « fut le premier pape à entrer dans les vues de Charles II et capable de les approuver ». Il accuse ainsi l’Église d’une façon plus que légère de s’être laissée corrompre et d’avoir menti dans une affaire grave. En outre nous savons que Boniface VIII était un éminent canoniste et jurisconsulte et que rien ne le faisait transiger lorsqu’il s’agissait de principes et de la vérité.
Charles II
Bien sûr il n’est pas épargné par Mgr Saxer : « Ou bien c’est le prince ou ses conseillers qui l’auront introduit [le texte du VIIIe siècle] dans le sarcophage entre le 9 et le 18 décembre »… « La première hypothèse [celle-ci] pourrait être la plus vraisemblable ».
Nous ne manquons pas d’accusés, mais seulement de preuves « hypothèse », « pourrait », « vraisemblable » : voilà les arguments fournis par ceux qui réclament un acte notarié en bonne et due forme dressé à l’arrivée de la famille de Béthanie sur le rivage provençal.
De plus rien n’autorise à accuser ainsi Charles II, prince d’une grande piété, dont les bulles attestent la dévotion à Marie-Madeleine.
Les dominicains
Ce sont eux que Launoy a accusés d’avoir « machiné la découverte » : « eux seuls avaient inventé les inscriptions et les avaient cachées où ils voulaient qu’on les trouvât » ; « les deux principaux acteurs de cette vilaine comédie étaient Guillaume Tonnesio, conseiller et confesseur du roi, et le vénérable père Elie, qui avait de nombreuses révélations au sujet des reliques de sainte Marie-Madeleine ».
Or les dominicains ne furent installés à Saint-Maximin qu’en 1295, soit quatorze ans après la découverte, et non sans réticence de leur part. De plus nous savons que Charles II a hésité avant de décider s’il laisserait la relique sur place ou s’il la déposerait en un autre lieu. Quant à Guillaume de Tonnenx, il n’a jamais été confesseur de Charles II ; nommé par Boniface VIII en 1295, il n’a gardé le prieuré que 6 mois environ et n’a jamais exercé les fonctions de sa charge dont il s’est démis entre les mains du souverain pontife à cause de son âge avancé avant de rentrer en France et de se retirer au couvent de Marseille. Et le bienheureux Elie n’était pas né.
Les bénédictins
S’ils avaient participé à une supercherie, ils n’auraient pas manqué de la dénoncer puisqu’elle ne tournait pas à leur avantage, Charles II mettant à leur place des dominicains comme gardiens des reliques. Et Charles II les aurait curieusement remerciés.
Les textes découverts
Ils étaient conservés à la sacristie, à la disposition de qui voulait les examiner. Bernard Gui a précisé : « Moi-même, qui écris ces choses, j’ai vu et lu ce très vieux parchemin qui est conservé pour rendre témoignage à la vérité ».
Mais, Mgr Duchesne a écrit à propos du texte du VIIIe siècle « que cet authentique soit apocryphe, c’est ce qui crève tous les yeux non provençaux » (de même qu’il disait de l’abbé Faillon qu’il était dispensé d’avoir de l’esprit critique parce qu’il était provençal !) en objectant dans ce texte l’emploi du comput, la formule « anno Nativitatis », la mention des Sarrasins et celle du roi Eudes. Nous allons examiner ces objections l’une après l’autre.
le comput :
Mgr Duchesne dit qu’en 710 on ne datait pas encore en France et surtout dans le Midi par l’ère de l’Incarnation. Cette façon de dater, dit-il, est venue d’Angleterre où on la voit employée par Bède dont l’« Histoire ecclésiastique » est de l’année 735.
Mais dans le « Nouveau traité de diplomatique » est mentionné un « acte de donation faite à l’église Saint-Bénigne de Dijon », daté « anno ab Incarnatione Domini DCXXXII ». On trouve dans « L’art de vérifier les dates » : « L’ère de l’Incarnation a été introduite en Italie au VIe siècle par Denys le Petit, et en France au VIIe siècle, où elle ne s’est bien établie que sous le VIIIe siècle ». On le trouve aussi en Angleterre dans toutes les chartes des rois anglo-saxons à partir de 680.
la formule « anno Nativitatis » :
Mgr Duchesne prétend qu’on ne la trouve que dans les dernières années du XIIIe siècle, ce qui prouve donc que cet acte a été fait à ce moment-là.
Mais on trouve dans le « Nouveau traité de diplomatique » que « sur la fin du VIIIe siècle il était ordinaire de fixer le commencement de l’année à la Nativité de Notre-Seigneur ».
Toutefois dans les anciens cartulaires et en particulier dans celui de Saint-Victor, on trouve diverses manières de commencer l’année, tantôt en la faisant partir de l’incarnation, (25 mars), tantôt de la Nativité (25 décembre).
Cette variété de formules se rencontre dans les chartes du même lieu et de la même époque. Au contraire, dans les chartes du XIIIe siècle, c’est l’« an de l’Incarnation » ou l’« an du Seigneur » (« annus Domini ») qui sont utilisés. De plus, on y compte en nones, ides et calendes, ce qui n’est pas le cas dans notre texte.
Décidément, comme dit l’abbé Escudier, Mgr Duchesne n’a pas de chance avec les textes provençaux ! S’il les lit, il les lit d’un œil distrait !
Les Sarrasins
Mgr Duchesne écrit qu’« en 710 les Arabes musulmans étaient encore en Afrique… Les clercs et les moines de Saint-Maximin eussent été bien précautionneux s’ils avaient eu peur en ce moment de recevoir leur visite ».
Tout d’abord il n’est pas évident que la date indiquée par le texte soit 710 : c’est 710 le 60 jour de décembre, ou 715 le 1er jour de décembre ou même 716. N’ayant plus le texte nous ne pouvons donc faire que des hypothèses sur cette date et non affirmer que c’est 710. D’autre part, sur certaines copies de ce texte le mot « jour », « dies », manque, ce qui fait à ce moment-là 716 pour l’année.
Quoi qu’il en soit, après avoir fait de nombreux raids en Espagne dès 707, en 710 les musulmans attaquaient Ceuta, ville considérée comme la clef de l’Espagne et de l’Europe, sur le bord africain du détroit. Vers la fin d’avril 711 ils débarquent à Gibraltar et « leurs succès sont si rapides qu’au commencement de 713 il y avait presque dans toutes les villes voisines des Pyrénées des gouvernements arabes ».
Le martyre de saint Porcaire et de 500 religieux quelques années plus tard prouve que l’hypothèse des moines de Saint-Maximin n’avait rien de chimérique.
le roi Eudes
« Enfin, conclut Mgr Duchesne, quel est cet Odoin que l’on qualifie roi des Francs ? Un roi de ce nom ne se retrouve nulle part dans la longue série des rois de France. Il ne peut être question du roi Eudes (888-896) car de son temps la Provence obéissait au roi d’Arles, Louis. Aussi s’est-on jeté sur le duc d’Aquitaine, Eudes (Eudo), qui n’a jamais porté le titre de « rex francorum » et n’a jamais exercé une autorité quelconque au-delà du Rhône, dont il était séparé par la province wisigothique de Septimanie… Du reste, le nom « Eudo » n’est pas identique à « Odoinus » ; jamais un contemporain n’eût fait pareille faute ».
Comme nous l’avons déjà dit, le texte original est perdu. Nous ne pouvons donc discuter sur les lectures qui nous en ont été transmises par ceux qui l’ont vu, nous ne pouvons trancher s’ils ont fait des erreurs ou non.
Mais les auteurs du « Nouveau traité de diplomatique » répondent qu’« Odoinus, Odo, Eudes, Odoin, Odon, Odoic ne sont que les variantes d’un même nom et Odoin, roi des Francs, est le même qu’Eudes duc d’Aquitaine ».
Quant à son titre, les sources ne manquent pas pour le confirmer. Par exemple, Anastase le Bibliothécaire, chroniqueur du VIIIe siècle, nous dit : « il y avait onze ans que les perfides Sarrasins tenaient l’Espagne sous un joug cruel. Pour continuer leurs sanglantes conquêtes, ils tentèrent de passer le Rhône pour s’emparer de la partie de la France où Eudes régnait ».
De même dans le « Nouveau traité de diplomatique » : « Ce prince fut effectivement reconnu par le roi Chilpéric II pour souverain de toute l’Aquitaine ou ancien royaume de Toulouse. Il régna jusqu’en 735 sur les pays situés entre la Loire, l’Océan, les Pyrénées, la Septimanie et le Rhône, et même au-delà de ce fleuve. Non seulement les anciens historiens, tant nationaux qu’étrangers, lui ont donné la qualité de roi, mais on datait les chartes des années de son règne. Est-il donc surprenant qu’on lui ait donné le nom de roi de France ?… Il est familier à nos critiques modernes de taxer d’imposture les monuments dont ils ne peuvent se débarrasser ; leurs excès en ce genre rempliraient plusieurs volumes ».
En outre, du IXe au XVIIe siècle, on a ignoré complètement non seulement la royauté mais même l’existence d’Eudes, duc d’Aquitaine et roi des Francs; donc l’inscription de Saint-Maximin doit remonter au moins en-deçà du IXe siècle.
Un faussaire qui aurait voulu être cru ne l’aurait pas introduit à cause du silence des historiens sur la domination d’Eudes en Provence.
Enfin, la difficulté de lire ce texte, attestée par tous ceux qui l’ont vu, témoigne en sa faveur : s’il avait été fabriqué lors de la découverte on se serait arrangé pour qu’il n’y ait pas d’erreurs possibles, que ce soit suffisamment convaincant et qu’il n’y ait pas matière à discussion.
– l’inscription « Hic requiescit corpus Mariae Magdalenae »:
Launoy et Mgr Duchesne l’ignorent. Mais sa brièveté même prouve son authenticité. Nous savons par Le Blant qu’ « à l’époque de la décadence, c’est l’effet d’une sorte de loi que les formules se compliquent et s’allongent. Le style épigraphique suit la règle commune ; la formule « hic requiescit » va en se compliquant lorsque les temps s’avancent, et l’on voit successivement paraître chez nous, en 469, 473, 488 « hic requiescit in pace », « hic requiescit bonae memoriae », « hic requiescit in pace bonae memoriae », avec cette circonstance remarquable que la formule la moins simple est en même temps la plus récente ».
Donc l’inscription « hic requiescit » est au moins de la moitié du Ve siècle, tout comme le sarcophage : elle a été faite lors du transfert du corps de sa première sépulture dans le sarcophage. C’est pourquoi Mgr Duchesne l’a passée sous silence.
– La crypte et les sarcophages :
«Pour toute personne impartiale, poursuit Mgr Duchesne, la crypte de Saint-Maximin n’est autre chose que la sépulture d’une famille gallo-romaine du Ve ou du VIe siècle. Un monument du même genre se trouvait à La Gayole, près de Brignoles, non loin de Saint-Maximin ».
Précisons que Mgr Duchesne n‘est jamais venu à Saint-Maximin, malgré la demande que lui en avaient faite les dominicains, qu’il n’a donc jamais vu ni la crypte ni les sarcophages, pas plus que celui de La Gayole.
Il n’y a pas de similitude entre les deux lieux : La Gayole n’est pas une crypte creusée dans le sol, et, puisqu’il serait si facile de créer et faire croire une légende autour d’un tombeau, pourquoi personne ne l’aurait-il fait à propos de celui de La Gayole qui était le plus ancien tombeau chrétien connu ?
La crypte de Saint-Maximin est creusée à plusieurs mètres dans le sol, elle est très étroite ; ce n’est donc pas un oratoire privé.*
(*ndlr: Pendant les fouilles de 1993-1994, les archéologues ont découvert un baptistère paléochrétien à droite de la basilique, dont le sol était du même niveau que le sol de la crypte; déduction faite,la crypte n’était pas enterrée comme on l’a cru pendant des siècles, mais reposant tout simplement sur le sol antique de l’époque, ce devait donc être un tombeau aérien du type mausolée)
Le Blant déclare : « tout dans cette enceinte porte la marque d’un âge reculé ; les remplissages sur lesquels sont posés verticalement les losanges d’incrustations et les plaques à gravures se composent de débris antiques et de tuiles à rebords ».
Revoil, qui a restauré la crypte de Saint-Victor, affirme : « la crypte de Saint-Maximin est vraiment contemporaine du christianisme primitif en Provence et atteste l’antiquité de nos croyances ».
De plus, des travaux exécutés en 1859 ont fait « apparaître un couvercle de sarcophage de pierre à double versant et à oreilles saillantes en tout semblable au type des tombes romaines des Alyscamps d’Arles ; on a rencontré en même temps deux sépulcres de pierre et un autre formé, comme on le voit souvent, de grandes tuiles à rebords ».
Ainsi, nous sommes en présence d’un cimetière gallo-romain. Il était situé, comme le voulait la loi, en dehors de la ville et près de la route. C’est là que fut ensevelie Marie-Madeleine à sa mort. Après la paix de l’Église au IVe siècle une « memoria » fut construite sur son tombeau et son corps transféré dans un sarcophage de marbre.
Le sarcophage lui-même, enfin, nous donne la preuve de sa destination. A propos du tombeau attribué à saint Sidoine, dans lequel avaient été cachées les reliques de sainte Marie-Madeleine par les cassianites, Le Blant écrit : « l’ouverture quadrangulaire qui est pratiquée dans ce cartouche marque, à n’en pas douter, que le marbre a recouvert une tombe sainte ; c’était une de ces « fenestellae » par lesquelles les fidèles faisaient passer d’ordinaire dans l’intérieur des sépultures vénérées les objets qu’ils voulaient sanctifier et emporter comme des reliques. Grégoire de Tours, en décrivant le tombeau de saint Pierre au Vatican s’exprime ainsi : « Le chrétien qui vient y prier monte au-dessus du sépulcre ; par la « fenestella » il passe la tête et formule ses supplications ; l’effet ne s’en fait pas attendre si la requête est juste. Celui qui veut emporter une relique introduit de même quelque morceau d’étoffe… puis il jeûne, il veille et il demande humblement la protection de l’apôtre ».
Le sarcophage de sainte Marie-Madeleine a également cette « fenestella ». Lorsqu’on fit des travaux dans la crypte en 1904 à la suite d’un vol qui y avait été commis, on déplaça ce sarcophage et c’est alors que la « fenestella » fut découverte sur la face du tombeau attenante au mur.
Enfin, Mgr Duchesne et Mgr Saxer ont fait remarquer que ce sarcophage n’était pas en albâtre, comme le dit le texte du VIIIe siècle, mais en marbre. Il est en effet en marbre calcaire, mais se distingue des autres par sa blancheur, son éclat, sa limpidité qui peuvent le faire prendre pour de l’albâtre.
* * *
En conclusion, la réunion en ce lieu de tous ces faits parle en la faveur de l’authenticité des reliques et de leur découverte : Charles de Salerne aurait bénéficié d’une chance vraiment inouïe d’aboutir à un tel rassemblement de preuves lorsqu’il fit entreprendre des recherches dans l’église de Saint-Maximin.
Par quel heureux hasard l’histoire qui aurait été inventée à Vézelay au XIe siècle sur la sépulture de sainte Marie-Madeleine à Saint-Maximin aurait-elle amené la découverte en cette église de sarcophages chrétiens du Ve siècle et contenant précisément les restes de cette sainte ?
Bien loin d’être le fruit du hasard ou d’une machination, cette découverte fait au contraire le lien entre la tradition et l’histoire.